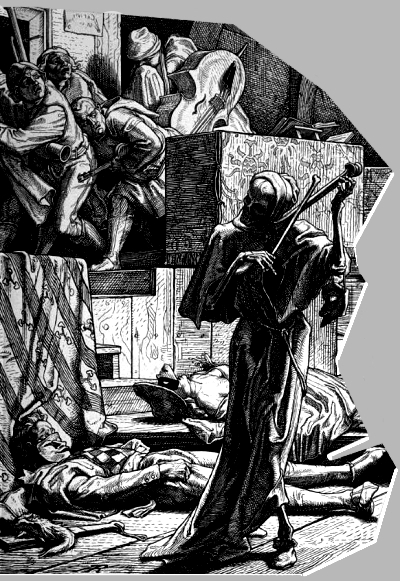Des assertions guère circonstanciées
mercredi XX juin MMVIIAndré Santini, mis en examen depuis 2006 pour « prise illégale d'intérêt » est à présent « secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique » (lien). « "Si un ministre était envoyé en correctionnelle, il quitterait le gouvernement. S'il était relaxé, il reviendrait. Tout homme est présumé innocent" a indiqué mercredi l'entourage du chef de l'Etat ».
Le discours tenu n'est pas choquant. Il est vrai, un citoyen non-condamné est présumé innocent. Il serait trop facile de nuire à autrui s'il suffisait d'accuser, et non de prouver, pour que cet autrui soit sanctionné.
On observe cependant qu'un renvoi devant la chambre correctionnelle n'est pas plus preuve de culpabilité qu'une mise en examen.
On peut s'interroger, par ailleurs, sur la compétence réelle pour être « chargé de la fonction publique » d'un homme qu'on parvient à soupçonner de prise illégale d'intérêt.
Finalement, on peut se demander ce que vaut la promesse formulée par monsieur « l'entourage du chef de l'Etat » de se débarrasser d'un condamné, vu qu'au sein du Gouvernement il y avait il y a peu, au ministère de l'écologie, un autre condamné.
Autre endroit, autres circonstances, un certain art de contourner le bocal est aussi à l'oeuvre lorsque le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, affirme que « le réchauffement climatique est en partie responsable du conflit au Darfour, où la sécheresse a entraîné la lutte pour les ressources en eau » (lien).
Il n'est guère surprenant dans le fond qu'un conflit aux contours ethniques repose en large part sur un problème économique, matériel.
Mais les origines d'un conflit, les raisons implicites ou explicites du conflit, ne sauraient se confondre tout à fait avec la mise en oeuvre de ce conflit, avec les pratiques des belligérants. Tous les conflits d'intérêts ne se transforment pas en guerres. Toutes les guerres ne se transforment pas en épurations ethniques.
À quoi bon se soucier de telles distinctions, vous demandez-vous ? Parce que cette distinction renseigne sur les structures morales des concernés. On ne peut pas traiter une guerre (lien) où se déroule des épurations ethniques, des massacres en série, comme un simple différend de voisinage. On ne peut pas considérer qu'il suffirait de résoudre le problème matériel qui nourrit le conflit, à supposer que cela soit possible, pour que l'incident soit clôt.
Retour en France, retour à notre actualité politicienne aussi bien qu'à notre passé honteux, par la lecture d'un article du site « Les mots sont importants », traitant du « cas Sarkozy ». Ce site est dédié à l'analyse de l'emploi des mots car « vivre dans l'omission de [l']évidence [que les mots sont importants] laisse la voie libre aux plus lourds stéréotypes, amalgames, sophismes et présupposés clôturant la pensée et la création mieux que ne le ferait la plus efficace des censures ».
Cet article, intitulé « Le Maréchal Sarkozy ou la régression sociale sous couvert de modernisme » (lien), compare deux discours, un de Nicolas Sarkozy, l'autre de Philippe Pétain, faisant remarquer qu'on y trouve dans les deux l'emploi des mots « travail », « effort », « mérite », « respect ».
Eric Brun, l'auteur de l'article, se demande « comment ne pas voir ici un retour aux valeurs de la Révolution nationale du Maréchal Pétain ».
L'auteur oublie de se demander si ces termes là étaient bien l'apanage de Pétain, dirigeant qui s'est installé au pouvoir en disant que son « programme est de rendre à la France les forces qu'elle a perdues ».
Il ne se demande pas non plus si ces mots qu'il a sélectionné sont si symptomatiques du régime de Vichy. « Respect », est-ce que le respect était le propre et le scandale de ce régime ?
Par ailleurs, il oublie de repérer les termes du discours de Sarkozy qu'on eut difficilement trouvé dans celui de Pétain : « dignité de la personne humaine », « progrès social ».
Il compare la critique « l'esprit de mai 1968 » par Sarkozy à « la critique de l'esprit 1936 » par Pétain. Mais Pétain ne condamnait pas qu'un esprit : il condamnait des actes précis qu'il imputait à un gouvernement, et pour cela il a fait se tenir à Riom un procès, procès qui a innocenté les dirigeants du Front Populaire.
L'auteur affirme que « devant cette situation, il est clair que le pouvoir en place, quand bien même il a recueilli une majorité des suffrages, n'est pas légitime », sans que l'on sache au juste comment il parvient à cette conclusion. Il déclare aussi que « la résistance au pouvoir sarkozyste incarne seule aujourd'hui l'esprit de résistance que ce pouvoir tente de récupérer. Nous en sommes les héritiers, nous qui avons toujours lutté contre les pouvoirs dominants et pour l'établissement d'un monde où les valeurs universelles sont celles du bonheur humain, du progrès social ». Qui est donc ce « nous » glorieux résistant ? L'auteur n'a t-il aucune honte d'employer le terme « progrès social », pourtant présent dans le discours de Sarkozy qu'il dit avoir analysé ? À moins qu'en fin analyste, pour qui « les mots sont importants », il soit apte à détecter, dans un discours, quels mots anodins rapprochent inévitablement Sarkozy de Pétain et quels autres mots très connotés sont en fait employés par Sarkozy par esprit malin.
Cocasse, l'auteur ose se présenter comme « qui a le souci de l'histoire » alors que l'ensemble de ses déclarations attestent d'un manque méthodologique consternant, doublé d'une totale absence de recherche d'objectivité.